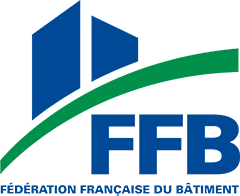Entretien avec Jean-Marc Gabouty, Vice-Président du Sénat
Je suis globalement favorable[…] à un dispositif de tauxréduits pour les rénovationsgénérales et énergétiques
Revitalisation des territoires ruraux et zonage de projet
La loi de finances pour 2018 a acté la révision à la baisse des dispositifs de soutien à la demande. Ces dispositions ont accentué la fracture territoriale qui existe entre les métropoles actives et les zones rurales en difficulté. Or, certains territoires ruraux, supposés peu tendus, recouvrent parfois des réalités plus complexes que celle exprimée par l’actuelle répartition du territoire en quatre zones. La FFB propose donc d’expérimenter le « zonage de projet » pour les aides au logement. Il s’agirait, pour une portion délimitée d’un territoire, d’autoriser des aides pour un nombre limité de logements. La lutte contre la fracture territoriale est un combat cher aux sénateurs radicaux.
Que pensez-vous de cette proposition ?
J-M. G. : Le zonage de projet est a priori une idée intéressante, dans la mesure où il permet d’adapter les projets d’aménagement aux réalités locales. Le groupe RDSE a, dans le même esprit, défendu la prorogation du PTZ jusqu’en 2020 lors du projet de loi de finances 2018. Cependant, il faudrait vérifier que le zonage de projet ne crée pas de disparités trop importantes par exemple à l’échelle d’un département.
Le zonage de projetest a priori une idéeintéressante
Il peut être difficile d’instituer des zones d’opportunité à périmètres spécifiques et à durées variables. Il faut aussi trouver d’autres moyens de favoriser les territoires ruraux par la réhabilitation et donc la revalorisation du bâti existant.
Compte tenu du stock de logements non utilisés, il convient de privilégier les opérations de rénovation ; cette orientation peut concerner aussi certains territoires urbains ou périurbains. Le faible coût du foncier et les aides à la rénovation constituent des atouts indéniables pour la revitalisation des territoires ruraux mais cette démarche ne peut être pertinente que si elle s’inscrit dans des projets plus globaux au niveau des territoires.
Micro-entreprise
Beaucoup d’artisans et de TPE, en particulier dans les territoires ruraux, souffrent de la concurrence déloyale exercée par les micro-entrepreneurs, ces derniers n’étant pas soumis aux mêmes obligations. Ainsi, la FFB désapprouve les mesures du projet de loi PACTE qui reviennent sur plusieurs dispositions de rééquilibrage introduites par la loi « Pinel » de 2014. Nous plaidons pour un encadrement du statut, notamment par sa limitation à deux ans du régime et l’interdiction de cumuler l’activité de microentreprise avec celle de salarié dans le même secteur d’activité.
Quel regard portez-vous sur ce régime ?
J-M. G. : Je comprends tout à fait les récriminations des artisans voire des petites entreprises face à l’éclosion de nombreux micro-entrepreneurs et d’autoentrepreneurs.
Au départ, l’auto-entreprenariat a été conçu soit comme une étape probatoire dans le processus de création d’entreprises, soit comme un statut adapté pour des personnes (retraités, étudiants, etc.) souhaitant exercer une activité complémentaire.
Encourager les initiatives individuelles et la création d’entreprises est essentiel, à condition que les statuts mentionnés ci-avant soient mieux encadrés afin de ne pas basculer dans le champ des pratiques de concurrence déloyale et d’assurer un minimum de professionnalisme et de garanties pour les clients.
je comprends tout à fait les récriminations des artisans face à l'éclosion de nombreux micro-entrepreneurs
Réseaux consulaires
L’implantation locale et le conseil que les réseaux consulaires apportent aux entreprises sont primordiaux. Cependant, les taux de participation aux élections des CCI et des CMA sont de plus en plus faibles et 65 % des artisans sont ressortissants des deux structures. En outre, les réseaux CCICMA mènent des actions similaires à destination des entreprises. À l’heure où les entrepreneurs et les artisans sont de plus en plus en attente de simplicité et d’efficacité, il serait judicieux d’opérer une mutualisation de certains services.
Quelles sont, selon vous, les conditions de pérennité du modèle consulaire ?
J-M. G. : En ce qui concerne les réseaux consulaires, je suis favorable au maintien de réseaux distincts entre les chambres de commerce et les chambres des métiers. Davantage de mutualisation est sans doute souhaitable en matière de forma lités, de conseils et d’animation du tissu d’entreprises. Ce rapprochement qui me paraît inéluctable doit cependant préserver, au sein de chaque réseau, des structures représentatives distinctes. Certaines fonctions très spécifiques, comme par exemple la création/transmission d’entreprise, se trouveraient ainsi renforcées dans le cadre d’un service unique commun aux deux chambres.
Rénovation énergétique
La transformation du « CITE » (crédit d’impôt pour la transition énergétique) en prime au 1er janvier prochain est un point essentiel auquel nous sommes attachés. En revanche, nous sommes vigilants quant à la volonté des pouvoirs publics de diminuer l’enveloppe budgétaire consacrée à la rénovation énergétique dans la prochaine loi de finances. Nous craignons que certains travaux (comme le remplacement des fenêtres et des chaudières à fioul) ne soient plus éligibles à ces crédits d’impôt. Après le rabot opéré fin 2017 sur le CITE – contre lequel le groupe RDSE s’était opposé lors des débats budgétaires – la FFB nourrit encore des craintes quant à l’enveloppe budgétaire qui sera consacrée à cette politique en 2019.
Ces inquiétudes vous semblent-elles justifiées ?
J-M. G. : La loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022 prévoit un encadrement des dépenses fiscales qui passe notamment par un mécanisme de plafonnement de leur part dans le budget de l’État. Cette approche, afin d’éviter l’effet d’empilage, est accompagnée d’une limitation dans le temps.
Les dispositifs de rénovation énergétique doivent s’apprécier dans la durée en évitant les ruptures brutales de régimes fiscaux comme ce fut le cas il y a quelques années pour le solaire afin de garantir aux entreprises une certaine stabilité ou une meilleure visibilité et de construire des filières industrielles dynamiques et durables.
L’apprentissage dans les métiers du bâtiment
Les entreprises du bâtiment accueillent la majorité des jeunes en formation par alternance, principalement dans le cadre de contrats d’apprentissage. Paradoxalement, alors que les pouvoirs publics font du développement de l’alternance un fer de lance dans la lutte contre le chômage, l’effort développé depuis des décennies par les entreprises du bâtiment pour favoriser l’accès à l’emploi de jeunes peu qualifiés n’est pas ou peu pris en compte dans les clauses d’insertion des marchés publics. Dans le but de promouvoir l’apprentissage, nous souhaitons donc développer la comptabilisation systématique des apprentis au titre des clauses d’insertion.
Que pensez-vous de cette proposition ?
J-M. G. : Le Sénat a examiné en juillet dernier le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les membres du RDSE ont présenté un certain nombre d’amendements en faveur du développement des contrats de professionnalisation ou d’apprentissage, afin d’encourager la formation et l’emploi des jeunes, sujets trop souvent négligés.
Le secteur du bâtimentet de la constructionjoue un rôle moteur dansce domaine