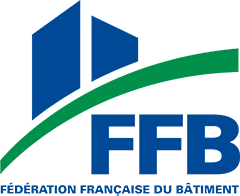Gestion des risques - L’alliée de l’entreprise
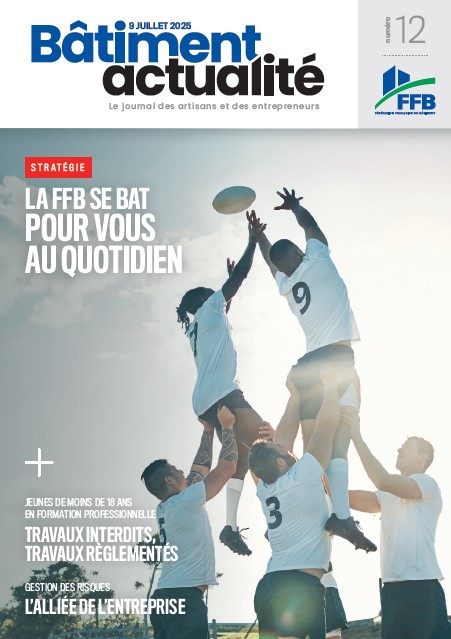
Identifier les risques
Voici quelques questions stratégiques à se poser :
- la non-prise en compte de cet enjeu peut-elle avoir un impact financier immédiat sur mon entreprise ?
- Y a-t-il un risque opérationnel ou juridique significatif lié à cet enjeu ?
- Ignorer cet enjeu repré-sente-t-il un risque de réputation ou d’image ?
- Existe-t-il un risque règlementaire imminent si je néglige cet enjeu ?
- Cet enjeu a-t-il le potentiel de perturber mon management interne ?
- Intégrer cet enjeu peut-il renforcer l’engagement de mes collaborateurs ?
- Cet enjeu ouvre-t-il des opportunités d’innovation pour mon entreprise ?
Vous pouvez aussi évaluer plusieurs dimensions clés :
- Gravité : quelle est l’ampleur potentielle des conséquences (financières, opérationnelles, réputationnelles) pour votre entreprise ?
- Irréversibilité : si ce risque se réalise, est-il réparable ou les dommages seront-ils permanents ?
- Portée : combien de collaborateurs, clients ou partenaires pourraient être impactés par ce risque ?
Ces dimensions vous permettent de mieux comprendre les enjeux associés à chaque risque et d’établir des priorités claires dans vos actions.
Pour vous aider à identifier vos risques, différents outils existent, dont le brainstorming, la checklist, la matrice SWOT (quatre carrés représentant visuellement les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces), l’analyse de Porter (concurrence sur un marché), etc.
Une fois ces risques clairement identifiés, inscrivez-les dans une matrice de suivi.
Tous les détails pertinents doivent être notés : la source du risque, les conditions de son apparition, les aspects de l’entreprise qu’ils pourraient affecter, les solutions envisagées, etc.
Cela vous permettra d’évaluer chaque risque selon sa gravité, sa fréquence et son urgence d’action. Cet outil vous aidera à prioriser et gérer efficacement chaque enjeu.
Piloter les risques : quels avantages ?
- Prise de décision éclairée, basée sur des informations complètes et actualisées.
- Avantage concurrentiel, un plan de gestion des risques dûment documenté peut permettre de gagner des parts de marché, lorsque ce dernier est ballotté.
- Actifs mieux protégés, qu’ils soient physiques, financiers ou immatériels.
- Performance financière améliorée, en évitant ou en réduisant les pertes potentielles.
- Crédibilité et confiance augmentées (collaborateurs, clients, banquier(s), partenaires).
- Allocation des ressources optimisée, en sachant situer les risques les plus forts.
- Culture d’entreprise améliorée grâce à une culture de responsabilité et de vigilance.
- Coût du capital réduit, en rassurant investisseurs et prêteurs sur la stabilité de l’entreprise.
- Flexibilité et réactivité accrues, car on est mieux préparé à répondre rapidement aux changements.
- Innovation stimulée, en permettant de trouver de nouvelles manières de gérer les défis ou de saisir des opportunités.
- Amélioration continue. Le processus de gestion des risques nécessite une réévaluation et une mise à jour régulières.
Analyser les risques
L’analyse des risques consiste à les classer les uns par rapport aux autres afin de se concentrer sur les risques les plus critiques.
Cela suppose de :
- partir d’un univers de risques objectivés le plus exhaustif possible ;
- hiérarchiser les risques en fonction du degré d’impact (risque limité, significatif, critique, catastrophique) et de la probabilité (risque improbable, rare, occasionnel, fréquent).
Chaque échelon doit être défini selon des critères clairs et chiffrés pour permettre de classer les risques de manière cohérente dans le plan de gestion des risques.
Quatre types de risques sont couramment observés dans une entreprise :
- risques financiers : fluctuations des marchés financiers, des taux d’intérêt, des matières premières, capacité de remboursement des dettes, problèmes de trésorerie ou de liquidité ;
- risques opérationnels : catastrophes naturelles, pannes techniques, cyberattaques ou perturbations de la chaîne d’approvisionnement peuvent perturber ou interrompre les opérations d’une entreprise. Mais des erreurs humaines, des défaillances de systèmes ou des lacunes dans les processus internes peuvent également entraîner des pertes financières et des problèmes opérationnels. En outre, la non-conformité aux règlementations, aux normes ou aux exigences légales fait encourir des sanctions financières ;
- risques liés à la réputation : une perte de confiance des clients peut être occasionnée par des problèmes de qualité ou de sécurité des produits ou services. De plus, les entreprises sont de plus en plus exposées à des risques liés à leur responsabilité sociale, tels que des questions environnementales, sociales ou éthiques ;
- risques liés aux ressources humaines : un important turnover des effectifs peut provoquer des perturbations opérationnelles et des coûts de recrutement et de formation. Le manque de compétences ou la pénurie de main-d’œuvre qualifiée peuvent ainsi entraver la croissance et l’innovation d’une entreprise.
Mettre en œuvre un plan d’action
Pour chaque risque prioritaire, déterminez la meilleure stratégie à adopter selon l’évaluation de la probabilité et de l’impact du risque, ainsi que des ressources disponibles pour y faire face :
- évitement : modifier les plans ou les processus pour supprimer complètement le risque ;
- transfert : utiliser des instruments (assurances ou contrats) pour transférer la responsabilité à un tiers ;
- atténuation : prendre des mesures pour réduire la probabilité ou l’impact du risque (adoption de nouvelles technologies, formations de sécurité, recrutement…) ;
- acceptation : reconnaître que le risque est inévitable et planifier des actions pour en minimiser les effets.
Pour les risques critiques, préparez des plans de contingence qui seront exécutés si les stratégies initiales ne suffisent pas à contrôler ou à atténuer le risque. Ces plans doivent se baser sur le pire scénario et définir des actions claires pour limiter les dégâts.
Le plan de gestion des risques
Ce document identifie, évalue et organise la réponse aux risques potentiels qui peuvent affecter un projet ou une entreprise.
Il implique une analyse de scénarios où chaque risque identifié est accompagné d’une série d’implications logiques (de type « si/alors ») qui ne laisse aucune place à l’improvisation et au tâtonnement.
Il se présente sous la forme d’un document qui énumère les risques auxquels l’entreprise est exposée en les classant selon :
- leur catégorie : risque stratégique, opérationnel, financier, légal, environnemental, etc. ;
- la probabilité d’occurrence : exprimée en pourcentage ou sur une échelle de notation standardisée ;
- leur impact potentiel, évalué en gravité, par exemple de « négligeable » à « critique » ;
- la priorité du risque, définie selon sa probabilité d’occurrence et son impact potentiel ;
- les stratégies de réponse ;
- les actions préventives ;
- le plan de contingence associé au risque en question ;
- la personne ou le service responsables de la surveillance et de la gestion du risque ;
- le statut du risque : actif, en cours de traitement ou résolu ;
- la date de dernière évaluation du risque.
Le plan de gestion des risques est généralement synthétisé sous forme de tableau pour permettre aux responsables de visualiser rapidement l’état de la gestion des risques, de classer les risques selon le critère souhaité (généralement, la priorité, le statut et la date de la dernière évaluation) et d’agir au bon moment.
Sans un tel plan, l’entreprise gérera ses risques de manière informelle et intuitive, avec le plus souvent une posture réactive plutôt que proactive :
- l’impréparation face aux risques aggrave les conséquences financières, réputationnelles et juridiques des crises et incidents sur l’entreprise ;
- les décisions sont prises dans l’urgence et sous pression, ce qui nuit à leur pertinence ;
- l’impact financier des incidents n’est pas préalablement évalué et budgétisé, ce qui menace la performance économique de l’entreprise, voire sa pérennité pour les risques à incidence majeure ;
- l’entreprise dépend de l’expérience individuelle pour la gestion de ses risques. La connaissance non formalisée est rattachée aux collaborateurs et se perd avec leur départ.
Suivre et revoir
Le plan de gestion des risques est dynamique : organisez des évaluations périodiques (à intervalles réguliers ou en réponse à un changement dans l’environnement opérationnel) pour réviser et actualiser les évaluations des risques et les stratégies de réponse.
La mise en place de la gestion des risques relève d’une véritable dynamique d’amélioration continue.

Identifier, évaluer, corriger, surveiller
La gestion des risques fournit des informations importantes qui aident à prendre des décisions éclairées. En comprenant les risques associés à différentes options, vous pouvez choisir les meilleures stratégies pour atteindre nos objectifs.