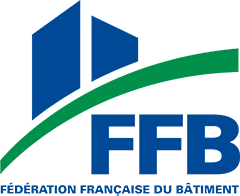La ministre chargée du logement a demandé l’élaboration, d’ici fin juin, de plans territorialisés de relance de la production de logements. Quels enjeux cela soulève-t-il pour les collectivités locales ?
David Lisnard — La crise du logement, plus que liée à la conjoncture économique, résulte avant tout de décisions publiques qui ont raréfié le foncier et rendu l’investissement immobilier peu attractif. En multipliant les contraintes législatives (loi SRU, Zéro artificialisation nette [ZAN]), en supprimant les incitations à construire, en asséchant les ressources des bailleurs, en contraignant la location avec le diagnostic de performance énergétique (DPE), en pénalisant fiscalement les propriétaires, l’État a détruit le modèle économique du logement. Ces décisions signent une vision de l’immobilier comme source de rentes et non comme investissement productif, et ont produit – exploit unique – une double crise de l’offre et de la demande.
Les communes en subissent chaque jour les effets. Elles accompagnent ceux qui n’arrivent pas à se loger, et sont sommées de construire du logement social tout en respectant d’innombrables restrictions, sous peine de lourdes sanctions financières.
Pour sortir de cette crise, l’AMF a formulé des propositions visant à libérer l’acte de construire. Nous proposons ainsi de décentraliser les zonages des politiques de logement, de simplifier les procédures d’urbanisme, d’accélérer les procédures de récupération foncière, de revoir la fiscalité sur la vacance ou encore de suspendre les mesures contraignant la production (loi Climat, DPE, etc.).
Nous avons également proposé de soutenir les communes qui participent à l’effort de production, par une compensation totale des exonérations de taxes sur les résidences, une incitation fiscale à l’investissement locatif et à l’accession à la propriété et une aide aux maires bâtisseurs. Une loi de programmation pour le logement donnerait enfin une visibilité bienvenue sur l’engagement de l’État et ses objectifs en matière de production, de rénovation et d’adaptation de logements.
Comment concilier sobriété foncière et réponses aux besoins de construction ? La proposition de loi Trace est-elle une bonne piste ?
D. L. — À partir d’une bonne intention (la lutte contre l’artificialisation des sols), on a créé, avec le ZAN, un dispositif si complexe qu’il est inapplicable localement, inéquitable, et pénalise le développement des communes, confrontées à des injonctions contradictoires.
Sans foncier, comment construire des logements et faciliter les implantations industrielles, comme le leur demande l’État ? La proposition de loi Trace vise à assouplir le dispositif du ZAN ; l’AMF y est donc favorable. Nous proposons de notre côté une méthode fondée sur le principe de subsidiarité, qui consisterait à partir de la réalité locale – à savoir la capacité réelle des communes à concilier lutte contre l’artificialisation et développement – pour fixer des objectifs nationaux.
Plus largement, il faut simplifier le droit pour fluidifier la construction. Remarquons que lorsque l’État mène de grands projets, comme la reconstruction de Notre-Dame, il prévoit des mesures dérogatoires et s’exonère donc des contraintes qu’il impose aux autres. Pourquoi ne pas généraliser ces mesures pour qu’elles profitent à toutes les collectivités et aux maîtres d’ouvrage ?
En attendant, les pouvoirs de dérogation du maire prévus par le Code de l’urbanisme pour les zones tendues pourraient être étendus à toutes les communes.
La production de logements sociaux est au plus bas alors que le nombre de demandeurs atteint des sommets. Comment appréhendez-vous cette question ?
D. L. — Il y a une déconnexion entre offre et demande de logement social. D’abord, les contraintes qui pèsent sur la construction et le modèle économique du logement social restreignent l’offre. La réforme de la RLS 1, la baisse de l’APL, le relèvement du taux de TVA et le désengagement de l’État du FNAP et de l’Anru(1) ont rendu le modèle économique du logement social moins favorable.
La nationalisation de la taxe d’habitation, la non-compensation des exonérations et abattements de TFPB(1) appliqués à la production de logement et la fin des aides aux maires bâtisseurs ont désincité les communes à construire, tandis que les contraintes normatives ont rendu la construction plus complexe et onéreuse.
Du côté de la demande, les critères d’éligibilité sont si larges (70 % de la population les remplit) que le législateur a été amené à créer des sous-catégories de logement social et à instaurer des mécanismes de priorité. In fine, la demande n’est pas satisfaite et il n’y a jamais eu autant de personnes sans domicile.
Pour soutenir l’offre, l’AMF porte dans l’immédiat plusieurs propositions : pérennisation du soutien financier aux collectivités dans le portage de projets comme avec l’Anru, meilleure répartition des établissements publics fonciers, accès élargi aux programmes nationaux (ORT, PPA, programmes de l’ANCT)…
Mais ces mesures ne pourront, à elles seules, résoudre l’inadéquation entre offre et demande : c’est tout le modèle qu’il faut revoir.