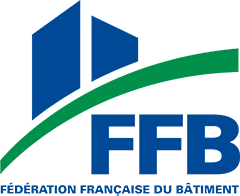Chantiers à fortes contraintes : quand construire devient un défi


Fort Énet : une contrainte nommée… océan
Situé sur un îlot à l’extrémité de la pointe de la Fumée, entre Fouras et l’île d’Aix dans le pertuis de la Charente, le fort Énet a été édifié sur ordre de Napoléon Ier entre 1809 et 1812, afin de protéger les bateaux construits à l’arsenal de Rochefort, tout proche des boulets anglais. Après avoir été un site militaire jusque dans les années 1950, inscrit à l’inventaire des monuments historiques en 1994, le fort a été vendu à des particuliers qui l’ont transformé en résidence secondaire et l’ont ouvert à la visite une cinquantaine de jours par an, quand le coefficient de marée est suffisant pour pouvoir accéder à l’île à pieds secs depuis la côte, en empruntant un gois.
En effet, à marée haute, le fort est complètement entouré d’eau, une contrainte qui a considérablement compliqué les travaux réalisés par l’entreprise TMH, spécialisée en taille de pierre, maçonnerie, charpente et couverture en monuments historiques, qui emploie une centaine de salariés à Villenave-d’Ornon (Gironde), pour maintenir en état ce bâtiment exposé aux rigueurs de la mer. « Les travaux que nous avons réalisés portent sur la base de la façade fortifiée ouest, d’une hauteur totale de 11 m, dont les trois premiers sont immergés à marée haute, ce qui sollicite énormément la maçonnerie », explique Philippe Delage, responsable du chantier. Nous avons réparé les boutisses cassées – pierres positionnées en largeur dans le mur – avec des goujons inox et de la résine, en utilisant de la pierre de Paussac, un calcaire demi-dur, et injecté dans la maçonnerie un coulis de chaux et de ciment prompt, un matériau à prise rapide qui laisse respirer la pierre. »
Les campagnes de travaux bénéficient d’une organisation quasiment « militaire » : il faut profiter de la marée basse pour acheminer non seulement tous les matériaux, outils et échafaudages nécessaires aux travaux, mais aussi prévoir le ravitaillement pour toute la semaine, puisque les compagnons dorment sur place. « Nous avons réussi à travailler jusqu’à six heures par marée, auxquelles s’ajoutent deux heures consacrées aux travaux sur les habitations du fort, qui connaissent des problèmes d’étanchéité », ajoute Alain Iviglia, dirigeant de TMH. Des efforts qui ont leur récompense : seuls au monde, en pleine nature, les compagnons se bousculent pour venir travailler dans ce cadre exceptionnel.
Pour complexifier le projet, il faut ajouter que le bâtiment existant se trouvait dans l’axe d’approche de la piste de l’aérodrome d’Aix-les-Milles, d’où l’impossibilité d’élever une grue avant l’atterrissage du dernier avion à 19 heures.
« Cette situation a créé une équation très difficile à résoudre, mais nous avons relevé le défi, relate Pascal Di Stefano, le dirigeant de Mù Fangzi, l’entreprise de construction bois qui a mené à bien l’opération. Notre métier, en effet, est précisément la conception de bâtiments en bois, en prenant en compte leur méthodologie d’exécution jusqu’au moindre détail, et notre valeur ajoutée tient dans les solutions qui répondent aux fortes contraintes. »
L’équipe d’encadrement de Mù Fangzi, composée de sept personnes dont un ingénieur, des techniciens dessinateurs et un directeur des achats, a commencé à travailler sur ce projet de l’architecte Alexandre de Besombes un an avant le début du chantier, afin d’optimiser chaque étape du processus et de garantir une mise en œuvre fluide et efficace.
L’opération a demandé un total de 1 600 heures d’études, l’exécution des travaux devant, elle, durer environ 450 heures, un ratio totalement inhabituel de l’ordre de 80 % de travail hors site contre 20 % de temps de chantier.
Dans l’impossibilité de faire une surélévation en raison de la nature du sol, le chantier a commencé par la déconstruction du bâtiment existant. L’une des exigences du maître d’ouvrage étant de désimperméabiliser les sols pour permettre une infiltration des eaux pluviales, les gravats générés par la déconstruction ont été utilisés au maximum sur place pour l’aménagement d’une rampe d’accès et d’un bassin de rétention d’eau.
Ce réemploi in situ des matériaux s’inscrit dans une démarche de frugalité constructive. L’édification se faisant sur un ancien marécage où il faut descendre à 7 m de profondeur pour trouver un sol dur, le choix de construire en bois s’est révélé tout à fait judicieux : la légèreté de ce matériau a en effet permis de trouver une solution alternative aux fondations en béton, sous la forme d’une plateforme mécano-soudée en acier, ancrée sur 300 pieux vissés à 7 m de profondeur.
Le bâtiment ne comporte donc pas d’éléments en béton – seule une chape en ciment de 5 cm d’épaisseur a été coulée pour des raisons acoustiques –, tout étant en bois, jusqu’à la cage d’ascenseur, et conforme aux exigences de la zone de sismicité 4 (moyenne).
Mais le défi principal a été de construire ce bâtiment R + 1 sans pouvoir installer de grue en journée : « On peut dire que nous avons réalisé un véritable chantier commando, ajoute Pascal Di Stefano. Pendant seize nuits consécutives, nous avons attendu l’atterrissage du dernier avion pour installer une grue à montage rapide à partir de 19 h 30 et décharger chaque nuit, à l’éclairage des ballons lumineux, deux à trois semi-remorques remplis de planchers en CLT et de façades à ossatures bois, qui étaient aussitôt posés sur la structure, en flux tendu et sans aucun stockage. »
L’éclairage était complété par des leds au sol, et chaque opérateur était équipé de lampes frontales et lignes de vie. Les commandes ont été anticipées plusieurs mois à l’avance, pour permettre une livraison séquencée sans rupture de flux. Un projet qui démontre que la coordination fine, l’engagement des équipes, et le recours à la filière bois permettent de relever des défis d’exception.
On peut dire que nous avons réalisé un véritable chantier commando.
Bâtiment d’habitation à Paris 12e : optimiser le peu d’espace disponible
Pour construire un immeuble d’habitation de 45 logements en R + 5, d’une surface habitable de 1 850 m² dans le 12e arrondissement de Paris, pour le compte du bailleur social In’li, Paris-Ouest Construction, une entreprise générale dont l’activité principale est la construction de logements collectifs neufs, a également fait face à de nombreuses contraintes.
Le bâtiment occupe en effet la presque totalité d’une petite parcelle située dans un milieu urbain très dense, en bordure d’une ruelle à sens unique.
« La problématique a été compliquée par l’impossibilité d’installer une grue en fût scellé, qui exige de couler du béton dans le sol, ce qui a été refusé par la maîtrise d’œuvre pour conserver la pleine terre et faciliter l’évacuation des eaux de pluie, explique Xavier Tournillon, directeur technique et de la Transition numérique du bâtiment de l’entreprise. Nous avons donc opté pour une grue sur châssis, ce qui a considérablement réduit l’espace disponible sur le chantier. »
En conséquence, aucune base vie n’a pu être aménagée sur place, ce qui a contraint l’entreprise à louer un appartement à proximité, pour y installer les locaux de l’équipe d’encadrement, jusqu’à ce que celle-ci puisse s’établir au rez-de-chaussée de l’immeuble en construction. Seuls des vestiaires et des sanitaires pour les compagnons ont pu être installés sur le chantier.
Dans l’impossibilité de stocker des banches sur le site, Paris-Ouest Construction a fait appel à une construction mixte, à base de prémurs préfabriqués pour les murs intérieurs, de linteaux en béton préfabriqués sur place et de planchers en béton coulés en place.
Les façades de l’immeuble ont été réalisées en pierres autoportantes de 24 cm d’épaisseur issues des carrières de Vassens (Aisne).
« Face au manque d’espace, l’autre contrainte majeure à laquelle nous avons dû faire face est celle des livraisons, ajoute le directeur technique. La solution que nous avons trouvée a été de demander à nos sous-traitants et fournisseurs de stocker provisoirement les matériaux à notre dépôt de Ballainvilliers (Essonne), puis d’organiser la livraison sur le chantier par camions petits porteurs, ce qui a entraîné des coûts supplémentaires. »
En définitive, les exigences environnementales et l’enclavement du chantier dans une véritable « dent creuse » urbaine ont amené l’entreprise générale à imaginer ses propres solutions techniques et organisationnelles, qui ont permis de rester fidèle au projet du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre Architectes Singuliers.
La problématique a été compliquée par l’impossibilité d’installer une grue en fût scellé, qui exige de couler du béton dans le sol, ce qui a été refusé par la maîtrise d’oeuvre pour conserver la pleine terre et faciliter l’évacuation des eaux de pluie.
Un bras de 55 m pour réaliser des chapes fluides
C’est encore le manque d’espace autour du bâtiment qui a contraint l’entreprise Alpes Carrelage, spécialisée dans les travaux de carrelage, isolation des sols et chapes fluides surtout pour les marchés privés, qui emploie une dizaine de salariés à Saint-André-d’Embrun (Hautes-Alpes) à imaginer une solution innovante pour pouvoir mettre en œuvre quelque 6 000 m² de chapes fluides.
« Étant implantés dans une région de montagne, nous avons l’habitude de réaliser des chantiers dans des zones difficilement accessibles, et en toutes saisons, explique son directeur Roland Dufourg. Mais récemment, c’est un chantier en plein centre-ville de Briançon qui a été particulièrement complexe. »
Pour construire ce bâtiment de 75 logements, occupant presque la totalité de la parcelle, l’entreprise de maçonnerie et l’entreprise de charpente ayant toutes les deux installé leur grue sur les emprises disponibles, l’entreprise de carrelage et de chapes ne pouvait plus acheminer ses matériaux de construction sur le chantier.
En conséquence, Alpes Carrelage a dû demander, par l’intermédiaire de la promotion et de la maîtrise d’œuvre, l’autorisation à un voisin mitoyen de passer par son garage pour livrer les isolants, les colles et les carreaux céramiques en pied d’immeuble, avant de les hisser jusqu’aux différents niveaux en utilisant un ascenseur de chantier.
La contrainte a été encore plus forte quand il s’est agi de réaliser les chapes fluides.
« Nous avons dû utiliser les grands moyens, ajoute le chef d’entreprise. La solution trouvée : demander une nouvelle fois l’autorisation d’installer le camion-pompe sur le parking d’une copropriété à proximité du chantier et le connecter aux camions-toupies pour envoyer le mortier sous pression, grâce à un bras de 55 m de longueur qui passait par-dessus la propriété du voisin pour atteindre le bâtiment. »
Ces deux solutions ont été proposées au promoteur pour obtenir les autorisations. L’entreprise avait déjà expérimenté ce dernier procédé pour réaliser des chapes fluides dans des chalets en altitude, où il n’y a pas de terrain plat pour pouvoir s’approcher avec un camion-toupie.
Chaque coulage d’étage a été optimisé, pour réaliser le maximum de surface par rotation et réduire ainsi le temps d’emprise des lieux et coût des opérations.
« Les méthodes ne sont pas toujours définies à l’avance pour les corps d’état secondaires, conclut Roland Dufourg. Dans le cas présent, nous sommes très fiers d’avoir fait jouer notre expérience afin de trouver des solutions. »
Étant implantés dans une région de montagne, nous avons l’habitude de réaliser des chantiers dans des zones difficilement accessibles, et en toutes saisons.
Une restauration patrimoniale en un temps record
Pour la restauration de la fameuse Auberge du Pont-de-Collonges près de Lyon (Rhône), c’est en premier lieu les délais de réalisation très courts qui ont donné le tempo mais pas seulement : il planait sur le chantier la figure tutélaire de la gastronomie lyonnaise, Paul Bocuse, qui a officié en ces lieux pendant plus de cinquante ans, avant de disparaître en 2018.
« L’Auberge était restée fermée en tout et pour tout un jour par an depuis la guerre », explique Jean-Luc Marion, dirigeant de l’entreprise Deroux-Dauphin Stuc et Staff à Vaulx-en-Velin (Rhône), et chargé de la maîtrise d’œuvre de cette opération en tandem avec le décorateur et designer Alain Vavro, qui fut un intime du pape de la cuisine française.
« Pour maintenir la continuité du service, et rester fermé un minimum de temps, poursuit-il, tous les travaux, qui ont commencé le 2 janvier 2019 juste après le Jour de l’an, ont été réalisés en vingt-trois jours et vingt-deux nuits. »
Pour relever le défi, l’enchaînement des travaux a été anticipé courant 2018 jusque dans les moindres détails, en associant les entreprises sous-traitantes et la maîtrise d’ouvrage, invitée à confirmer ses choix de matériaux et d’entreprises retenues le plus en amont possible des travaux.
Étant donné le nombre élevé d’intervenants – environ 25 entreprises – Jean-Luc Marion a vu dans la non-activité une source majeure de complications et pris la décision stratégique de scinder le chantier en trois plus petits :
« Le fait de créer un chantier “cuisines”, un chantier “sanitaires” et un chantier “salles de restauration/salons” a permis de faire avancer les travaux sur trois zones différentes et simultanément, en faisant travailler beaucoup de monde en même temps, et de gagner un temps précieux en limitant la non-activité, ajoute le chef d’entreprise et maître d’œuvre. Nous avons aussi travaillé de nuit, ce qui a permis à certains intervenants d’être seuls sur le chantier et de réaliser en toute sérénité certaines opérations délicates. »
Toutes les idées ont été mises à contribution pour travailler plus vite, en respectant la qualité des ouvrages, et toutes les entreprises ont accepté d’adapter leurs horaires pour les besoins du chantier. Par exemple, l’entreprise qui coule les chapes intervenait en fin de journée pour que l’ouvrage sèche pendant la nuit et qu’on puisse marcher dessus dès le lendemain soir.
Des nuits sans travaux ont été intégrées au planning pour pouvoir y traiter des aléas, comme le renfort non prévu de certaines poutres qui menaçaient de fléchir.
Les travaux en temps masqué ont permis de gagner un temps précieux, à l’image des ouvrages en staff qui ornementent les salles du restaurant et les espaces sanitaires, fabriqués et étuvés en atelier chez Deroux-Dauphin pendant la journée pour pouvoir être posés la nuit.
Dernière initiative pour optimiser encore le temps de chantier, certaines entreprises, notamment en charge des menuiseries intérieures et des habillages textiles, ont installé leurs ateliers et fabriqué sur place.
À l’issue des trois semaines de fermeture, la cuisine professionnelle a été refaite entièrement à neuf après cinq décennies de bons et loyaux services, et seul un piano historique du Maître a été conservé comme trace du passé. Le chauffage, la climatisation et la ventilation ont été entièrement refaits à neuf, de même que toute la décoration des parties communes et salles de restauration, dont on n’a conservé que le revêtement de sol d’origine en carrelage mosaïque.
L’excellence du résultat est à la mesure de l’héritage du grand cuisinier.
De ces différents exemples, il ressort que les chantiers à fortes contraintes mettent à l’épreuve les entreprises de travaux, en les obligeant à aller au-delà de la seule maîtrise des règles de l’art, pour réfléchir à une amélioration de leurs méthodes et à une simplification des processus, pour au final travailler aussi bien et plus vite, en apportant ainsi la preuve qu’aucune construction, ou presque, n’est impossible à réaliser.
Confrontées à des défis similaires, les entreprises générales démontrent la capacité attendue de leur part à organiser un chantier dans son ensemble pour honorer leurs engagements contractuels. Il en résulte une agilité, et une satisfaction à avoir relevé le défi, qui renforce leur crédibilité aux yeux des maîtrises d’œuvre et maîtrises d’ouvrage.
Nous avons travaillé de nuit, ce qui a permis à certains intervenants d’être seuls sur le chantier et de réaliser en toute sérénité certaines opérations délicates.