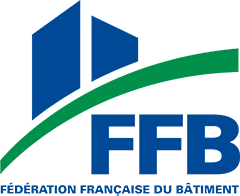Du fait de sa toxicité, l’usage du plomb dans le bâtiment fait l’objet d’interdiction ou de restriction d’usage, notamment au niveau des peintures ou des canalisations d’eau potable. En revanche, sans préjuger de l’évolution de la réglementation, l’emploi des feuilles ou tables en plomb pour la couverture, les balcons ou l’étanchéité de bacs de douche n’est pas, à ce jour, interdit. L’essentiel du marché du plomb en couverture concerne néanmoins des ouvrages existants, essentiellement en monuments historiques ou de patrimoine.
Le plomb et la santé
Le plomb peut pénétrer dans l’organisme par inhalation (poussières, fumées, particules) ou par ingestion (contact avec la bouche, déglutination de poussières inhalées). En revanche, il ne passe pas à travers la peau.
Les effets du plomb
L’exposition régulière au plomb peut entraîner de nombreux problèmes de santé regroupés sous le terme de « saturnisme » et pouvant devenir graves. Ingéré ou inhalé, le plomb se retrouve dans le sang et se fixe sur les tissus mous, ainsi que sur le système osseux et dentaire où il peut être stocké par accumulation. Il peut également
être responsable d’anomalies au niveau
de la reproduction chez la femme
comme chez l’homme.
La surveillance biologique de l’exposition au plomb par son dosage (dans l’urine et le sang) permet d’estimer rapidement l’atteinte de l’organisme. Le plomb s’élimine très lentement par les voies naturelles.
Les pathologies provoquées par l’exposition au plomb peuvent être reconnues comme maladie professionnelle au titre du tableau 1 des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale.
Les modes de contamination
Le plomb peut pénétrer dans l'organisme par inhalation (poussières, fumées, particules) ou par ingestion (contact avec la bouche, déglutination de poussières inhalées). En revanche, il ne passe pas à travers la peau. Les risques liés au plomb en couverture sont essentiellement liés à la manipulation du plomb pouvant générer des poussières et des fines particules, ainsi qu’au soudage qui génère des fumées toxiques.
Le travail sans protection, le manque d’hygiène individuelle, l’alimentation avec les mains sales, le fait de fumer ou de mâcher de la gomme ou encore l’utilisation d’objets personnels au travail (téléphone, bijoux, briquet, etc) constituent des facteurs de contamination par ingestion.
Par ailleurs, hors du lieu de travail, par les particules déposées sur le corps (cheveux, moustache, barbe, peau) ou sur les vêtements, chaussures ou objets personnels pouvant être importées dans les véhicules et au domicile, les intervenants peuvent continuer à se contaminer et à contaminer leurs proches.
Les mesures de prévention professionnelles
L'exposition au plomb est soumise à une réglementation très stricte, qui protège les travailleurs et leurs familles. Les composés du plomb sont en effet classés au niveau européen comme toxiques pour la reproduction. Le code du travail identifie également le plomb et ses composés comme facteurs de risques professionnels au titre de l’environnement physique agressif.
Les mesures de prévention, qui s’appuient sur les principes généraux de prévention, doivent respecter les dispositions particulières aux agents chimiques CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction). Leur objectif est de réduire l’exposition des travailleurs au niveau le plus bas techniquement possible. Ces mesures concernent également les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs exerçant directement une activité sur un chantier de bâtiment.
En pratique pour les chantiers en couverture, l’essentiel de la prévention réside dans une organisation soigneuse du travail et le respect des règles d’hygiène individuelle méticuleuse afin de diminuer la contamination par les mains et les vêtements :
- au niveau de l’organisation du chantier, un nettoyage des postes de travail par aspiration ainsi qu’une protection des surfaces (établis) par du polyane ;
- pour le démontage du plomb, le port de vêtements jetables est conseillé ;
- à défaut les vêtements doivent être changés régulièrement (notamment le midi) et nettoyés fréquemment ;
- Le port de gants lors de toute manipulation d’élément en plomb est obligatoire ;
- des vestiaires avec séparation des vêtements de ville et des vêtements de travail, doivent être mis à disposition. Ils permettent également le lavage des mains ;
- le personnel doit être sensibilisé à l’hygiène, notamment des mains (lavage, brossage et coupe des ongles) et les comportements à risque pour l’ingestion de plomb (ne pas fumer, ne pas manger, ne pas mâcher de gomme pendant le travail) doivent être interdits ;
- la prise de douche et le changement de vêtements après le travail doit être systématisée (pollution des cheveux).
Ces mesures ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre et seule une information et une prise de conscience des salariés au quotidien permet de faire respecter les consignes.
Le suivi médical du salarié
En plus du respect des consignes de prévention, les salariés exposés au plomb doivent être soumis à un suivi médical individuel renforcé. Un suivi individuel renforcé est assuré si l’exposition à une concentration de plomb dans l’air est supérieure à 0,05 mg/m3 (calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de 8 heures), ou si une plombémie élevée (supérieure à 200 µg de plomb par litre de sang pour les hommes et 100 µg/l pour les femmes) est mesurée chez un travailleur (article R. 4412-160 du Code du travail).
Le suivi médical comprend un examen d’aptitude qui permet de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté. Cet examen est effectué à l’embauche et est renouvelé périodiquement par le médecin du travail. Le suivi comprend également une information individuelle du salarié sur son niveau de plombémie et sur les moyens de prévention qu’il doit mettre en œuvre.
Le contrôle de l’exposition
Le Code du travail fixe pour le plomb métallique et ses composés une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) réglementaire contraignante de 0,1 mg/m3, à ne pas dépasser en moyenne sur 8 heures dans l’atmosphère des lieux de travail (article R. 4412-149). Le respect de cette valeur limite d’exposition professionnelle doit être considéré comme un objectif minimal de prévention. L’exposition des travailleurs doit être réduite au niveau le plus bas techniquement possible.
Les valeurs limites biologiques (VLB) réglementaires contraignantes à ne pas dépasser sont fixées à 400 µg de plomb par litre de sang pour les hommes et à 300 µg/l de sang pour les femmes (article R. 4412-152). Le contrôle du respect des valeurs limites réglementaires (VLEP et VLB) du plomb doit être réalisé par des laboratoires accrédités (selon les modalités prévues par 2 arrêtés du 15 décembre 2009). L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l’employeur de faire procéder à un contrôle de ces valeurs.
En cas de dépassement des limites biologiques, le médecin du travail, s'il considère que ce cela résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative et le travailleur. Les postes de travail concernés sont arrêtés jusqu’à la mise en œuvre de mesures propres à assurer la protection des travailleurs (articles R.4412-82 du code du travail) et ce quel que soit les résultats de mesure de la VLEP.
L’évaluation du risque plomb
Les différentes enquêtes menées à la suite de dépassement des valeurs limites biologiques indiquent le plus souvent un non-respect des règles de prévention et d’hygiène, mais aussi une absence de l’évaluation des risques d’exposition (source : Évaluation du risque plomb sur un chantier de couverture – OPPBTP 2007).
Il est donc à la fois indispensable de faire respecter les mesures de sécurité - notamment le port des EPI et les mesures d’hygiène – et de savoir d’où proviennent les risques d’ingestion et d’inhalation de plomb.
Le plomb est un élément polluant, sa localisation n’est pas circonscrite aux seuls matériaux qui en contiennent dans leur composition initiale, il peut se répandre par dissémination.
Le patrimoine bâti ancien est, dans la presque totalité des cas, susceptible de contenir du plomb, qui peut se présenter sur le chantier sous différents états :
- Le plomb à l’état massif mis en œuvre sous forme de tables, d’ouvrages divers de couverture ou de canalisations ;
- Le plomb à l’état de composé (oxydes, sulfates etc) présent comme additif dans les peintures, apprêts, sous-couches et céruses antérieures au XXe siècle et dans certains plâtres anciens ;
- Le plomb sous forme soluble qui par lixiviation sous l’effet du ruissellement est transposé sur des matériaux exempts de plomb à l’origine de leur mise en œuvre ;
- Le plomb à l’état de poussières, issu notamment de la pollution rémanente et des additifs anti-détonants utilisés dans les carburants jusqu’au 2 janvier 2000, est présent dans les poussières déposées sur les matériaux en surface en fonction de la porosité des matériaux (façades sols...). La libération de plomb sous forme de poussières est aussi provoquée par la manipulation ou le foulement des plaques de plombs anciennes. Il est de fait fréquemment présent lors d’intervention dans les combles, sur les planchers et leurs structures et les cloisonnements.
L’évaluation du risque plomb peut s’appuyer sur un diagnostic avant travaux. Au titre du code de la santé publique, l’obligation faite au maître d’ouvrage d’effectuer un diagnostic avant travaux est uniquement dans le cas de travaux portant sur les parties à usage commun d’un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l’habitation, construit avant le 1er janvier 1949, et de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements. Ces travaux doivent être précédés d’un constat de risque d’exposition au plomb (CREP) qui concerne tous les revêtements, y compris les revêtements extérieurs. Une analyse des poussières permet également de fournir des éléments tangibles pour évaluer préalablement les risques.
L’analyse des poussières, selon une cartographie la plus exhaustive possible des supports qui renferment du plomb, doit concerner les zones potentiellement contaminées non accessibles avant travaux (exemple pour une couverture en plomb il est probable que la charpente et les planchers du comble soient chargés de poussière de plomb).
L’analyse du risque plomb en couverture permet de définir les principales mesures de prévention contre l’exposition au plomb et notamment le respect des règles d’hygiène strictes.
Un guide pratique pour organiser les chantiers en présence de plomb
Un travail collaboratif regroupant notamment la FFB, le GMH, les architectes du patrimoine, l’INRS, le ministère du travail, le ministère de la santé et le ministère de la culture a permis la rédaction d’un guide pratique destiné aux intervenants sur les chantiers de patrimoine : "Organisation des chantiers patrimoniaux en présence et avec maintien du plomb".
Ce guide, bien que dans sa version provisoire, est mis à votre à disposition. Les entreprises peuvent s’y référer notamment pour les mesures de prévention contre la dissémination du plomb, les équipements de protection collective et individuelle. Il rappelle également les responsabilités des maitres d’ouvrage, des maitres d’œuvre et des entreprises, ainsi que les étapes de préparation des chantiers, de l’identification des supports à la réception, en passant par la conception, la préparation des pièces écrites et l’exécution.
Connectez vous pour télécharger le guide...