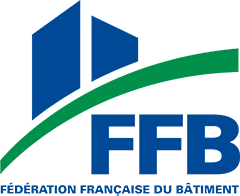L’utilisation d’un drone peut faciliter un diagnostic ou un état des lieux, par exemple sur des monuments historiques ou des immeubles de grande hauteur, sans avoir recours à la mise en place d’échafaudages. De plus, le drone peut également assurer un soutien dans le cadre du suivi des travaux. Enfin, le stockage des données permet de conserver une trace sur l’évolution d’un chantier.
Le terme de « drone », couramment employé, n’apparaît pas dans la règlementation. Celle-ci fait référence à des « aéronefs qui circulent sans équipage à bord », ce qui correspond au sigle anglais « UAS » pour Unmanned Air Systems.
L’entreprise responsable de l’activité d’usage d’un drone à titre professionnel est appelée « exploitant ». Le télépilote qui est la personne qui réalise un vol donné, pour le compte de l’exploitant. Dans le cas d’un exploitant unipersonnel (ex : entreprise individuelle), l’exploitant et le télépilote sont une seule et même personne.
Une réglementation européenne selon l’usage
L’utilisation en extérieur d’engins volants, même lorsqu’ils sont de petite taille, qu’ils ne transportent personne à leur bord et qu’ils sont utilisés à basse hauteur, est considérée comme une activité aérienne et relevait donc principalement de la réglementation applicable à l’aviation civile. La compétence sur la réglementation des drones relève désormais de l’Agence de l’Union européenne de la sécurité aérienne (AESA). Ainsi les deux principaux textes applicables sont :