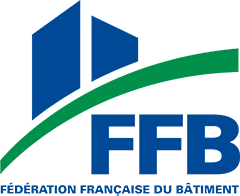Préfabrication : de nombreux points forts à exploiter


La préfabrication, point fort de l’entreprise
La préfabrication des équipements techniques bénéficie des mêmes points forts que celle des éléments structurels ou de l’enveloppe. Implantée à Reims (Marne) depuis plus de quarante ans, où elle emploie cent salariés, la SCOP COPRECS, spécialisée dans l’installation d’équipements liés au génie climatique, préfabrique dans son atelier quasiment tous les locaux techniques qu’elle réalise, notamment des chaufferies et des sous-stations de chauffage et/ou de production d’eau chaude sanitaire. « La préfabrication nous permet de travailler en temps masqué dans notre atelier et de gagner du temps en installation sur le chantier, explique son président du directoire, Fabien Dauchelle. En rénovation, cela limite les temps de coupure de chauffage ou d’eau chaude sanitaire sur le site, ce qui est très apprécié des maîtres d’ouvrage et des occupants. »
Le recours à la préfabrication nécessite de réaliser des études précises avant de démarrer les travaux : relevé des dimensions sur site, prise en compte des contraintes d’accessibilité et de maintenance des différents équipements, relevé précis des points de raccordement en rénovation. Parmi les avantages de la préfabrication en atelier, l’utilisation de notre pont roulant et l’aménagement de l’atelier améliorent le confort et l’ergonomie des postes de travail, notamment pour les opérations de soudure. De plus, toutes les pièces détachées sont à disposition de nos compagnons dans notre magasin, ce qui évite les allers-retours sur chantier, en cas d’oubli. « Autre avantage, le bureau d’études est à proximité de l’atelier et peut intervenir aussitôt quand il y a un doute ou une erreur à corriger, ajoute le dirigeant. Pour ma part, je ne reviendrai pas en arrière sur l’utilisation de la préfabrication, qui est un point fort de l’entreprise depuis sa création et encore aujourd’hui.
La préfabrication ne s’oppose en rien aux autres modes constructifs, qu’elle complète.
Qualité industrielle et attractivité des métiers
Comme évoqué ci-avant, les solutions techniques préfabriquées sont diverses, de l’élément préfabriqué 1D linéaire (poteaux, poutres, poutrelles, longrines, linteaux, gaines, conduits, etc.), à l’élément préfabriqué 2D (prédalles, planchers, prémurs, panneaux, menuiseries, façades, bardages, volées d’escaliers, balcons, coursives, tableaux techniques, modulaire 2D…) jusqu’aux éléments préfabriqués 3D (salles de bains, blocs sanitaires, chambres, cellules, gaines techniques ou palières, locaux techniques, CTA… et construction modulaire 3D) dans lesquels le niveau de préfabrication, d’intégration et de finition peut être plus ou moins poussé.
« Quoi qu’il en soit, la préfabrication déplace la problématique en amont du chantier et amène à consacrer beaucoup de temps en phase d’études avec des outils en 3D, afin de concevoir les ouvrages avec le plus de rigueur possible, permettant surtout la minimisation du risque de modifications durant l’exécution, ajoute Jacques Blanchet. Mais cet investissement se révèle fructueux au moment de l’assemblage sur site, car les composants fabriqués en atelier ou usine bénéficient d’une qualité mieux maîtrisée, qui impacte positivement la qualité globale du bâtiment. »
À l’instar de beaucoup d’entreprises, le groupe Blanchet a investi dans la construction d’un atelier qui lui permet aujourd’hui de préfabriquer des façades métalliques en recourant à la modélisation 3D reliée à un parc de machines à commande numérique, un fonctionnement proche de celui de l’industrie. En dix ans, la part de la fabrication en atelier est ainsi passée de 55 % à 85 %. Enfin, la préfabrication participe à la modernisation des métiers du bâtiment : travailler avec des process technologiques, en atelier et dans de bonnes conditions de sécurité, peut améliorer l’image des métiers, leur attractivité et potentiellement leur niveau de féminisation.
« Nous sommes capables aujourd’hui de livrer un mur entièrement préfabriqué, avec la menuiserie extérieure et la vêture.
Un procédé pertinent pour la rénovation énergétique.
La préfabrication, notamment dans le cadre des filières sèches de la construction bois et construction métallique, a trouvé un important débouché dans les réponses qu’elles peuvent apporter au défi de la rénovation énergétique des bâtiments. C’est ainsi que les façades préfabriquées, qui sont couramment utilisées pour réaliser une isolation thermique par l’extérieur (ITE), sont devenues une part importante de l’activité, notamment des entreprises de construction bois.
Le chantier de rénovation des Aygalades-Oasis, un groupe scolaire situé à Marseille (Bouches-du-Rhône), réalisé par l’entreprise de construction bois Roux, filiale du groupe G2C, illustre bien cette tendance. « Sur ce projet, nous avons pris en charge le lot façades, consistant à fabriquer 1 600 m2 de panneaux de façade à ossature bois (FOB) ou construction ossature bois (COB) en 2D, explique Thomas Charmasson, le directeur général de l’entreprise.
Dans le cadre de la réhabilitation, les façades ossatures bois préfabriquées viennent notamment fermer la structure en métal des bâtiments existants, construits dans les années 1960, mais nous aurions pu en faire de même avec une structure en béton, comme cela se fait très souvent aujourd’hui. » Pour le chef d’entreprise, le fait de recourir à la préfabrication se justifie pleinement sur ce type d’opération.
En premier lieu, le temps de chantier a été réduit à huit semaines pour la phase 1 du projet, alors qu’il aurait été quatre fois plus long en construction traditionnelle, ce qui a permis au maître d’ouvrage, La Société des écoles marseillaises, de réduire d’autant les nuisances de chantier pour le voisinage.
Nous pensons que l’immense marché de la rénovation énergétique est aussi une opportunité de promouvoir une construction responsable, qui inclut des objectifs en matière de bilan carbone, et de l’insertion par l’activité économique, grâce à la fabrication en atelier.
Comme le souligne Thomas Charmasson, cette logique de préfabrication peut aller très loin : « Nous sommes capables aujourd’hui de livrer un mur entièrement préfabriqué, intégrant la menuiserie extérieure et la vêture. » Mais pour cela, encore faut-il que l’ensemble des intervenants travaille de manière coordonnée, notamment en BIM, ce qui est encore trop rarement le cas. Par ailleurs, certains lots ou prestations sont parfois définis trop tard, ce qui empêche leur intégration en amont.
La préfabrication permet de gagner un temps précieux sur chantier, mais ces gains peuvent être annulés si certaines prestations restent à réaliser sur site, parfois dans des conditions météorologiques défavorables. D’où l’importance cruciale d’une préparation rigoureuse et anticipée, dès les premières phases du projet.
Charpente de Notre-Dame de Paris : un chantier préfabriqué exemplaire
Si on a vu les maçons et tailleurs de pierre s’activer pendant toute la reconstruction sur la cathédrale, d’autres partitions se jouaient loin du site. C’est le cas des charpentes médiévales du chœur et de la nef, qui ont été reconstituées, avec les techniques de l’époque, dans les ateliers de deux entreprises spécialisées dans les monuments historiques, les Ateliers Perrault (Saint-Laurent-de-la-Plaine, Maine-et-Loire), qui a pris en charge les études, en groupement avec les Ateliers Desmonts (Nassandres-sur-Risle, Eure).
La réalisation de ces ouvrages exceptionnels – 32 m de longueur, 140 t et 860 pièces de bois pour le chœur, 39 m de longueur, 180 t et 1 000 pièces de bois pour la nef – a commencé par une sélection des chênes sur pied, dans des forêts françaises, en collaboration avec l’ONF. Une fois acheminées en atelier, les grumes ont été équarries comme on le faisait au Moyen Âge, à l’aide de soixante haches et doloires fabriquées de façon artisanale pour le chantier. Étape essentielle de la fabrication, les épures ont permis de tracer au sol la projection des fermes, suivies de la mise en ligne, du piquage, du taillage et de l’assemblage des bois de charpente.
Après un marquage méthodique de chaque élément, un montage à blanc des charpentes a été réalisé en atelier, comme une répétition générale. Démontée et transportée sur le chantier, chaque ferme a été assemblée au sol, levée et posée par grutage au sommet de la cathédrale. Reconstruite dans les règles de l’art, la « forêt » de Notre-Dame avait repris sa place.
Satisfaction du maître d’ouvrage et insertion par l’activité
Pour la SCOP Macoretz, une entreprise générale tous corps d’état implantée à Saint-Père-en-Retz (Loire-Atlantique), la préfabrication est une réponse globale qui lui permet d’atteindre bon nombre de ses objectifs. C’est ce qui transparaît à travers l’opération RESO, un chantier de rénovation énergétique portant sur un ensemble de huit logements sociaux R + 1 situé à La Chapelle-des-Marais (Loire-Atlantique).
Cette opération qui s’inscrit dans la logique « EnergieSprong » s’est traduite par le remplacement du chauffage gaz par une pompe à chaleur, l’installation d’une VMC et de panneaux photovoltaïques en toiture, sans oublier une isolation thermique extérieure sous forme de « murs manteaux » en bois, réalisée par Macoretz.
Pour la mener à bien, l’entreprise a modélisé numériquement le bâtiment, ce qui a permis de concevoir chaque panneau sur mesure, pour garantir une adaptation parfaite lors de la pose. Les trente-cinq panneaux préfabriqués ont été réalisés en atelier avec intégration de l’isolation, des fenêtres et du bardage en bois.
Si le temps consacré aux études a été de trois mois, suivi de deux mois consacrés à la fabrication, la pose des murs a été réalisée en seulement six jours, à l’aide d’une grue mobile, d’un camion-grue et d’une nacelle.
« La réussite d’une telle opération dépend en grande partie de la rigueur de la conception et du dimensionnement des murs en bois, insiste Xavier Lebot, le directeur général de Macoretz. Si ce n’est pas le cas, toute erreur au niveau de la prise de cote se traduit par des adaptations compliquées à faire sur le chantier, qui en compromettent la qualité. »
En ce qui concerne l’opération RESO, le maître d’ouvrage, le bailleur CISN (Trignac, Loire-Atlantique), a pu compter sur des nuisances minimales pour les occupants : sans la préfabrication, ils auraient eu à subir pendant plusieurs mois les coups de marteau pneumatique dans la façade pour y fixer les isolants.
Au-delà, la logistique de chantier a été fortement allégée et la pose des MOB a été réalisée à l’aide d’une nacelle chaque fois que c’était possible ou grâce à un échafaudage dans les endroits inaccessibles. « Cette opération est un bon exemple de l’offre que nous proposons aujourd’hui aux bailleurs sociaux, résume Xavier Lebot. Nous pensons que l’immense marché de la rénovation énergétique est aussi une opportunité de promouvoir une construction responsable, qui inclut des objectifs en matière de bilan carbone, et de l’insertion par l’activité économique, grâce à la fabrication en atelier. » En effet, on estime chez Macoretz que, si la construction traditionnelle sur le chantier exige des compagnons formés sur le plan des métiers et de la sécurité, la fabrication en atelier, où on travaille en temps masqué avec des conditions de sécurité optimisées, se prête parfaitement à l’intégration de salariés en insertion, ce qui a été mis en application sur le projet RESO.
La préfabrication traditionnelle modulaire
Le recours à une préfabrication plus large peut aussi être un moyen de s’adapter aux évolutions du marché et de la société – voire de les devancer –, comme le montre l’exemple du Groupe Pelletier, implanté à Méry (Savoie), qui était à l’origine une entreprise de gros œuvre – Barel & Pelletier – qui a évolué en devenant entreprise générale et acteur de la promotion immobilière. « Pour un ensemble de raisons, la construction traditionnelle devient de plus en plus problématique, en particulier dans notre région, explique Patrick Pelletier, son président. Il semble que le rapport au travail ait changé, et il est devenu difficile de trouver les compétences nécessaires pour réaliser un chantier in situ, ce qui entraîne une baisse de la qualité des ouvrages, des retards de livraison, et une baisse de compétitivité.
De plus, la neige se fait de plus en plus rare en Savoie et Haute-Savoie, et cela a pour conséquence une réduction des projets de construction neuve. Pour moi, il ne fait pas de doute que l’avenir de notre activité passe par une préfabrication poussée. » En réaction à cette situation, le Groupe Pelletier a créé une nouvelle filiale, AlphaM.3D, à partir d’une start-up rachetée en 2023, qui est positionnée sur la préfabrication modulaire. Son activité est de fabriquer en usine des modules – d’une dimension optimale de 2,50 m de large sur 6,12 m de long et 3,04 m de hauteur – composés d’une dalle en béton et de porteurs verticaux pouvant être en béton, en métal ou en bois, qui permettent par empilement et boulonnage de construire des bâtiments complets, notamment ceux qui ont une trame répétitive, comme les résidences étudiants, résidences seniors, hôtels ou bureaux.
Il ne fait pas de doute que l’avenir de notre activité passe par une préfabrication poussée.
Nous pensons que la solution aujourd’hui est plutôt une préfabrication “sous-ensemblière
Cette offre répond aussi aux importants besoins de rénovation énergétique des bâtiments construits en zones montagneuses dans les années 1960 et 1970, qui sont souvent des passoires thermiques. « Les copropriétaires hésitent à se lancer dans une rénovation énergétique coûteuse, ajoute le directeur général. Grâce au concept modulaire d’AlphaM.3D, nous leur proposons de financer cette opération, en échange d’un droit à construire pour la réalisation avec nos modules de surélévations et d’extensions, d’autant plus qu’ils sont conformes à la réglementation imposée par la zone de sismicité classée 4 de notre région et à la RE 2020 seuil 2028. »
Pour le chef d’entreprise, la préfabrication modulaire est aussi un levier pour résoudre la problématique majeure du coût de construction trop élevé et améliorer sa compétitivité. En effet, la fabrication en usine associée à une conception poussée grâce aux outils numériques permet de réduire les coefficients de sécurité qui sont appliqués sur le chantier, afin d’obtenir les dimensionnements minimaux exigés par les normes et de réduire ainsi mécaniquement les quantités de matériaux mis en œuvre, dont le coût a tendance à augmenter.
Penser « sous-ensembles
La construction hors « du » site enjeu de préfabrication est aussi une solution à l’encombrement urbain, dans les centres-villes où il y a peu d’espace pour implanter des installations de chantier et où les maîtres d’ouvrage veulent limiter les nuisances pour les occupants en rénovation ou les riverains en construction neuve. Directeur du développement des solutions Hors Site chez Eiffage Construction, et président de la commission « Nouveaux modes constructifs et nouveaux bâtiments » du syndicat des Entreprises Générales de France (EGF-FFB), Jacques Bouillot pense que la préfabrication et sa logique industrielle sont de plus en plus pertinentes aujourd’hui, en raison de bâtiments qui sont de plus en plus complexes à construire, du fait de l’empilement des différentes réglementations, d’autant plus que certains matériaux décarbonés comme les bétons très bas carbone sont plus longs à sécher et nécessitent une attention particulière lors de leur mise en œuvre sur le chantier.
Mais on aurait tort, selon lui, de prêcher l’extrême inverse en n’envisageant la préfabrication que d’un point de vue entièrement et seulement modulaire, qui impose une répétitivité du design et présente le risque d’une uniformisation de la construction, même s’il est toujours possible de personnaliser les finitions extérieures. « Nous pensons que la solution aujourd’hui est plutôt une préfabrication “sous-ensemblière”, explique-t-il, qui prend le meilleur de la préfabrication, consistant à arbitrer, à partir du projet de l’architecte, et à décider quels sous-ensembles du bâtiment vont être réalisés sur place ou externalisés (via des modules, des panneaux, des éléments, etc.).
Elle correspond exactement à notre activité d’entreprise générale, assembler des pièces toujours différentes, d’un bâtiment toujours différent. » Et de prendre, pour illustrer ses propos, l’exemple de la résidence Adoma de 98 logements qui sera livrée en plein cœur de ville à Lyon (Rhône) en 2025, pour le compte du groupe CDC Habitat. Pour l’entreprise générale, le recours à la préfabrication sous-ensemblière s’est imposé comme une évidence, sous la forme de trois sous-ensembles : les murs de remplissage en béton de bois produits par Spurgin (CCB Greentech), les salles de bains HVA Concept fabriquées par le pôle Hors Site du groupe Eiffage, et les gaines techniques également préfabriquées. « Nous travaillons avec une multitude d’entreprises sous-traitantes partenaires, résume Jacques Bouillot.
La préfabrication sous-ensemblière est une belle alternative permettant de répondre aux contraintes imposées par le projet, tout en intégrant notre réseau d’entreprises dans une réflexion amont en atelier, au travers de groupements, par exemple, qui sont susceptibles de nous fournir des parties de bâtiments en multicorps d’état. » Au-delà des questions techniques et de qualité, la préfabrication correspond à une approche différente de la construction.
Celle-ci implique un changement culturel dans les entreprises, mais aussi du côté de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre qui, pour en tirer tous les bénéfices, doivent favoriser un raisonnement en macro-lots et confier à l’entreprise qui préfabrique tout un sous-ensemble du bâtiment. Un travail d’adaptation des textes normatifs doit sans doute aussi être effectué, pour mieux définir les limites de prestations dans la préfabrication et ainsi lever toute ambiguïté relative à l’assurabilité des sous-ensembles et des modules.